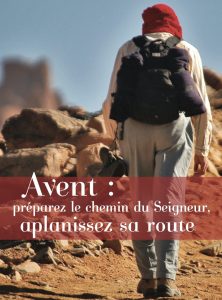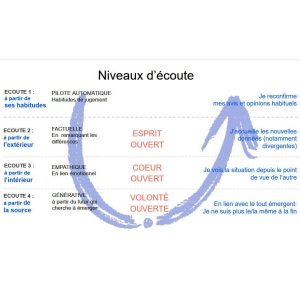Il y a moins d’un siècle, des ethnologues, des anthropologues, des missionnaires, pouvaient avoir le loisir d’étudier ce que l’on qualifiait alors de “peuples primitifs”. De quoi s’agissait-il ? En Australie, Nouvelle-Guinée, Afrique, Amérique du Sud, etc., vivaient encore des populations ne connaissant ni la ville, ni l’Etat, ni même l’argent, non plus que le principe de propriété. Or il fut observé que, sauf cas extrêmement rare et spécifique, il n’y avait parmi elles nulles castes ni rien qui y ressemblât de près ou de loin.
Pour la plupart des spécialistes de l’époque, la raison de cette curiosité apparente ne faisait absolument pas mystère : les “peuples primitifs” se caractérisaient tout simplement de ne pratiquer ni l’agriculture, ni l’élevage. Ils étaient ce que l’on nomme aujourd’hui communément des “chasseurs-cueilleurs”. Pire encore, les plus “primitifs” d’entre eux pratiquaient des formes de chasse, de pêche et de cueillette ne leur permettant même pas de constituer plus de réserves qu’il n’en faut pour passer les éventuelles périodes de pénurie annuelles, du moins là où il en existe.
Il n’était donc pas difficile de conclure que la condition première de la stratification de la société, c’est tout simplement l’existence d’excédents de production. En fait, à partir d’un certain niveau de développement technique dans la production des subsistances nécessaires à la vie humaine, apparaissent des surplus qu’il faut stocker et conserver, d’où l’importance archéologique de l’étude de la poterie, notamment. Dès lors que ces surplus abondent en quantité suffisante, ils deviennent la condition première de vie d’une ou plusieurs catégories d’individus pouvant s’abstraire de toute activité directement productive : prêtres, guerriers professionnels, artistes à plein temps, médecins, commerçants, princes, fonctionnaires, etc. Or l’observation objective de l’histoire des civilisations humaines impose de remarquer que, quoique ces excédents n’aient offert à l’origine que l’occasion à ces castes d’apparaître, elles le firent cependant systématiquement et universellement.
Il est donc parfaitement légitime de déduire de ces constatations une loi générale : plus la productivité du travail humain augmente, plus tend à augmenter le nombre d’individus consommant une part du produit du travail social sans rien produire eux-même de substantiel en retour. Ce sont des intellectuels, des artistes, des “chefs” ou les médiateurs de “puissances de l’au-delà” et, bien entendu, leurs “activités” relèvent d’une importance infiniment supérieure à celles, bassement matérielles, de l’ouvrier ou du paysan.
Mais on comprend bien que l’appropriation des fruits du labeur des uns par les autres ne va pas de soi, et qu’elle implique tout un ensemble extrêmement complexe de justifications, mêlant idées d’ordre religieux ou philosophique à des principes juridiques, à des traditions ancestrales, des coutumes qu’il est interdit d’interroger, des mythes, des systèmes de valeurs tellement incorporés par les sujets qu’ils ne les questionnent même plus, des croyances, des superstitions, de pseudo-sciences, etc. Ces plus ou moins vastes et élégantes constellations d’idées explicites et implicites, qui constituent ce que nous sommes accoutumés à appeler “culture”, servent essentiellement à dissimuler la contrainte bien réelle exercée sur les producteurs par des moyens tout simplement violents (polices, armées, etc.), et à limiter le plus possible le recours direct à cette violence en obtenant de leur part une assomption des systèmes de légitimation qui les assujettissent, telle qu’ils accordent une forme de consentement (la “servitude volontaire”) à la soumission et la dépossession qui leur sont imposées, en réalité, de force.
En vérité, si je puis m’exprimer ainsi, dans toute société civilisée et, a fortiori, à plus forte raison dans la société hyper-moderne que constitue la nôtre, la violence de caste se situe très précisément au coeur du coeur du principe qui régit toute l’organisation sociale et ses expressions multiples, à commencer par la prolifération technique dont le ressort n’a jamais été autre que l’augmentation vertigineuse de la productivité du travail, pour les raisons que j’ai déjà dites. C’est la raison pour laquelle le fétiche Argent (Mamon) semble être le prince de ce “monde de ténèbre”.
A des seuils de développement plus primitifs, ce qui est monétarisé et donc transformé en marchandise, ce ne sont bien entendu que les excédents de production, qui sont échangés afin d’acquérir d’autres marchandises, issues d’autres excédents. Lorsque l’on aborde les rivages de la société moderne, l’on constate que la monétarisation est totale et universelle : tout est devenu marchandise, jusque l’être humain lui-même qui se vend et s’achète, tout entier sur le “marché du travail”, ou bien débité en organes… Cela signifie que la dépossession est désormais totale. Le travailleur ne détient plus que sa peau, ses os et sa cervelle qu’il est contraint de louer quotidiennement pour assurer sa subsistance.
La marchandisation est absolue, c’est-à-dire que plus rien n’échappe à la loi de la valeur et de l’échange : l’excédent a tout absorbé – les “castes improductives” possèdent rigoureusement tout, directement ou indirectement (via le crédit et les circuits financiers).
Si j’ai honte, par exemple, de n’être titulaire d’aucun diplôme (je parle ici en général car, à titre strictement personnel, j’en suis au contraire très fier), la raison en est tout simplement que le diplôme est un label qui certifie officiellement ma qualité de marchandise, exactement comme le Label rouge constitue la garantie qu’un poulet a été élevé conformément à un certain cahier des charges. Le diplôme est la marque-même de ma servitude, dont je me fais un blason pour exister dans un monde où tout est marchandise.
Est-il honorable de se résigner à cela sans rien faire, sans rien dire ? Je ne le pense pas. Le mal qui me ronge intérieurement n’est pas indépendant de celui qui est au principe de notre monde. Il n’y a pas de salut individuel, et c’est la raison pour laquelle le Christ a fondé une Église (Ecclesia – l’assemblée) hors de laquelle, selon le vieil adage, il n’y a point de salut. Le rôle de l’Église militante, c’est de militer, c’est-à-dire de mener le combat contre “les puissances et les dominations de ce monde de ténèbres” et, à mon avis, si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place.
Plus profondément, le mal qui me ronge et celui du monde sont en réalité analogues : ils se perpétuent ensemble ou seront vaincus ensemble, pas l’un sans l’autre. Alors bien sûr, individuellement, nous n’avons pas la clef, et la grande guerre qui oppose l’Église au monde nous dépasse infiniment. Mais, pour moi, être véritablement chrétien, c’est demeurer envers et contre tout porteur de la promesse du triomphe de l’Église : Mamon sera vaincu et les castes abolies, et avec elles l’argent et l’État. L’Assemblée Universelle (Ecclesia Catholica), dont le fondement est la Parole, va triompher et régner. Rien de particulièrement mystique là-dedans : cela signifie tout simplement que les affaires humaines seront régies par les Hommes eux-mêmes, indépendamment de tout pouvoir séparé ; que nous allons devenir libres, puisque plus aucun instrument d’oppression ne pourra intervenir dans le règlement des questions humaines par la libre discussion ; qu’à la violence et la contrainte policières, uniques fondements du lien social dans le monde contemporain, va se substituer un principe ancien et neuf à la fois : l’amitié ; que le lien communautaire (la Communion) qui unissait les membres de la tribu primitive va renaître, mais porté à la dimension de l’Universel. En un mot comme en cent : que toutes nos chaînes, qu’elles soient économiques, politiques, juridiques, idéologiques ou même psychologiques, seront anéanties, à tout jamais et que, par conséquent, tous nos désirs, les plus profonds comme les plus puissants seront réalisés, parce que nous vivrons réellement et effectivement de la Vie Divine…
Mais ce triomphe, dont nul ne connaît le jour ni l’heure, n’aura pas lieu sans nous. Si nous sommes l’Église, c’est à travers nous que Dieu agit dans le monde. Nous sommes ses guerriers, ses combattants, et nous avons à affronter pour les anéantir définitivement des puissances étatiques, financières, militaires et policières gigantesques en face desquelles nous paraissons, certes, dérisoires. Pourtant, le Bon Dieu nous a promis la victoire, alors de quoi avons-nous peur ?
Alexandre Billaud